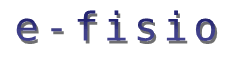science grecque, science arabe, science latine :
les origines de la biologie moderne
présentation
télécharger le diaporama au format pdf 960 Ko (2 diapositives par page)
télécharger le diaporama au format Powerpoint (compressé) 228 Ko
télécharger le diaporama au format Powerpoint (compressé) 228 Ko
L’objectif de ce cours n’est pas de traiter – en deux heures – les
sciences grecques, arabes et occidentales, mais de brosser un tableau
rapide et succint des origines de la science « occidentale » telle
qu’elle s’est développée en Europe occidentale à partir de la fin du
Moyen Âge et à la Renaissance, et dont la science actuelle est
l’héritière directe.
schéma général du cours : bref tableau historique
Classiquement,
on considère que la science moderne a comme origine la pratique
scientifique née en Grèce, la continuité – plus ou
moins chaotique – entre science grecque et science moderne se faisant
par l’intermédiaire de l’empire romain, héritier de la
culture grecque et assurant ainsi sa transmission dans la partie
occidentale du monde méditerranéen ; après une
longue période de « sommeil scientifique »
commençant avec la chute de l’Empire romain d’Occident, ce
corpus de connaissance transmis de manière « froide
» – essentiellement dans quelques monastères – est sorti
de son hibernation au moment de la Renaissance. En remettant en cause
le corpus de connaissance greco-romain – mais en renouant avec
l’analyse critique qui avait permis de le constituer – les savants de
la Renaissance ont fondé la science moderne. Ainsi, de nombreux
ouvrages d’histoire des sciences présentent-ils l’aube de la
science comme étant le monde hellénique, et passent
directement des penseurs grecs à la Renaissance. Les quelques
auteurs médiévaux cités sont surtout des auteurs
de l’Europe occidentale, écrivant en latin, choix qui
réduit l’histoire des sciences à une histoire «
occidentale » des sciences. On peut se demander si ce cadre
d’analyse est pertinent.
En effet, sans nier l’importance de la Renaissance et les révolutions conceptuelles qui en ont découlé, il faut dire que la transmission du savoir grec ne s’est pas effectué de cette façon, et que le monde « occidental » – l’empire romain dans sa partie occidentale – n’a joué qu’un faible rôle dans la transmission du savoir scientifique et philosophique grec au cours du Moyen Âge. En effet, la transmission de ce savoir s’est faite surtout par le proche et le moyen Orient, fortement hellénisé après les conquêtes d’Alexandre le Grand. Le peu d’intérêt des Romains pour l’activité scientifique a fait que les principaux centres de formation intellectuelle – même après la conquête de la Grèce par les romains – sont restés dans la partie orientale de la Méditerranée. La chute de l’Empire romain d’Occident, la constitution de l’empire bizantin, la fermeture d’écoles et la migration de communautés de lettrés aux marges de l’empire bizantin et en Perse a entraîné un déplacement vers l’Orient de ce savoir grec. Avec l’avènement de l’Islam et le développement de l’empire arabo-musulman, ce corpus de connaissances d’origine grec, enrichi de quelques apports persans et indiens, va être incorporé au monde islamique, à l’initiative principale du califat de Bagdad, et va diffuser dans l’ensemble du monde arabo-musulman – Bagdad, Damas, Alexandrie, Le Caire, Kairouan, Fez, Cordoue, Tolède, Grenade. A la fin du Moyen Âge, ce savoir hellénique, ayant intégré quelques apports syriaques et indiens, enrichi de l’apport des penseurs du monde arabo-musulman, passera dans le monde chrétien occidental, principalement par l’Italie puis par l’Espagne.
En effet, sans nier l’importance de la Renaissance et les révolutions conceptuelles qui en ont découlé, il faut dire que la transmission du savoir grec ne s’est pas effectué de cette façon, et que le monde « occidental » – l’empire romain dans sa partie occidentale – n’a joué qu’un faible rôle dans la transmission du savoir scientifique et philosophique grec au cours du Moyen Âge. En effet, la transmission de ce savoir s’est faite surtout par le proche et le moyen Orient, fortement hellénisé après les conquêtes d’Alexandre le Grand. Le peu d’intérêt des Romains pour l’activité scientifique a fait que les principaux centres de formation intellectuelle – même après la conquête de la Grèce par les romains – sont restés dans la partie orientale de la Méditerranée. La chute de l’Empire romain d’Occident, la constitution de l’empire bizantin, la fermeture d’écoles et la migration de communautés de lettrés aux marges de l’empire bizantin et en Perse a entraîné un déplacement vers l’Orient de ce savoir grec. Avec l’avènement de l’Islam et le développement de l’empire arabo-musulman, ce corpus de connaissances d’origine grec, enrichi de quelques apports persans et indiens, va être incorporé au monde islamique, à l’initiative principale du califat de Bagdad, et va diffuser dans l’ensemble du monde arabo-musulman – Bagdad, Damas, Alexandrie, Le Caire, Kairouan, Fez, Cordoue, Tolède, Grenade. A la fin du Moyen Âge, ce savoir hellénique, ayant intégré quelques apports syriaques et indiens, enrichi de l’apport des penseurs du monde arabo-musulman, passera dans le monde chrétien occidental, principalement par l’Italie puis par l’Espagne.
Les termes
de science « grecque », science « arabe » ne
font pas référence à une origine
géographique, religieuse ou « nationale » mais au
contexte culturel – et linguistique – dans lequel cette science s’est
développée. Si les premiers penseurs « grecs
» étaient effectivement nés en Grèce et de
langue grecque, le monde culturellement et linguistiqument
hellénisé s’étend largement au-delà de la
Grèce géographiquement définie. De même, les
termes de science « arabe » ne font référence
ni à une science limitée ni même née en
Arabie, ni portée par des Arabes ou par les Musulmans – il y a
parmi les grands noms de cette science arabe des Persans (qui ne sont
pas des Arabes), des Chrétiens (Arabes ou non) et des Juifs.
Mais cette science s’est développée dans le monde
politique et culturel arabo-musulman, dont la langue de communication
scientifique était massivement, sinon exclusivement, l’arabe.
Le
cours présente l'évolution et la transmission du
savoir en "science de la vie" depuis l'époque grecque antique
jusqu'à sa transmission, principalement par l'Italie et par
l'Espagne, dans l'Europe occidentale latine. Il s'articule de la
façon suivante :
I. science grecque et héllenistique
naissance d'une philosophie naturellle : tentative d'explication rationelle du monde
l'émergence d'une "science du vivant" : médecine et histoire naturelle
les grands noms : Hippocrate, Aristote, Galien de Pergame
les centres de formation :
II. le glissement vers l'orient
Les Romains et la science
L'empire bizantin
La Perse et Jundishapur
III. La science arabe
Bagdad
l'expansion vers l'ouest
les grands noms : Rhazi et Avicenne (+ Hunain, Maimonide et Ibn-al-Nafis)
IV. La transmission à l'Occident
L'Italie
L'Espagne
conclusion : impact sur le développement des sciences à la fin du moyen-âge et au début de la Renaissance.
I. science grecque et héllenistique
naissance d'une philosophie naturellle : tentative d'explication rationelle du monde
l'émergence d'une "science du vivant" : médecine et histoire naturelle
les grands noms : Hippocrate, Aristote, Galien de Pergame
les centres de formation :
Cnide et Cos : les écoles de
médecine ;
Athènes : le Lyceum et l'école aristotélicienne ;
Alexandrie : le Musée et la Bibliothèque.
Athènes : le Lyceum et l'école aristotélicienne ;
Alexandrie : le Musée et la Bibliothèque.
II. le glissement vers l'orient
Les Romains et la science
L'empire bizantin
La Perse et Jundishapur
III. La science arabe
Bagdad
l'expansion vers l'ouest
les grands noms : Rhazi et Avicenne (+ Hunain, Maimonide et Ibn-al-Nafis)
IV. La transmission à l'Occident
L'Italie
L'Espagne
conclusion : impact sur le développement des sciences à la fin du moyen-âge et au début de la Renaissance.
Évaluation des connaissances et compétences
connaître les grandes étapes de l'élaboration et de la transmission du savoir en "science de la vie" - médecine et histoire naturelle - depuis la Grèce antique jusqu'à l'Europe occidentale au XIe et XIIIe siècle, dont :
- les repères chronologiques
- les repères géographiques
- les principaux personnages
- les centres de formation et de transmission du savoir
évaluation des connaissances
examen
final basé sur une question rédactionnelle, avec éventuellement une réponse de
type QCM.