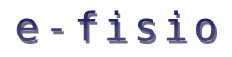Darwinisme social et eugénisme
[enseignement
semestre 2] document complémentaire [retour au document principal : notion de bioéthique]
Introduction
L’impact de la
théorie darwinienne de l’évolution a largement
dépassé le cadre scientifique. En effet, en proposant une
histoire de la vie opposée au récit biblique de la
Genèse, et plus encore en proposant un mécanisme
explicatif ne faisant pas intervenir la notion de finalité et ne
faisant pas de l’homme le but ultime de l’apparition de la vie, la
théorie darwinienne de l’évolution a eu un impact
indéniable, immédiat et persistant sur les conceptions
métaphysiques et sociales. En fait, la théorie
darwinienne a suscité un intérêt philosophique
considérable et dans plusieurs domaines, y compris dans le
domaine socio-politique.
Nous aborderons ici ce que l’on appelle, depuis la fin du XIXe siècle, le « darwinisme social », c’est-à-dire l’utilisation de la théorie darwinienne de l’évolution comme justification de théories sociales débouchant sur des préconisations politiques et sociales.
Nous aborderons ici ce que l’on appelle, depuis la fin du XIXe siècle, le « darwinisme social », c’est-à-dire l’utilisation de la théorie darwinienne de l’évolution comme justification de théories sociales débouchant sur des préconisations politiques et sociales.
Dès la publication par
Charles Darwin en 1859 de L’Origine
des espèces, et bien que cette question n’ait pas
été traitée par Darwin lui-même dans son
ouvrage, la question s’est posée de savoir si la théorie
de l’évolution darwinienne s’appliquait également
à l’homme, y compris dans ses relations sociales :
l’organisation sociale de l’homme peut-elle être analysée
en terme darwinien ? Et si oui, comment ?
Très
rapidement après la publication de L’Origine des espèces,
des auteurs comme Herbert Spencer et Francis Galton ont
extrapolé les principes élaborés par Darwin
à l’analyse des organisations sociales. Pour désigner ces
théories socio-politiques est apparu vers 1880 le terme de
« darwinisme social ». Il désigne les
théories qui voient dans les lois sociales le prolongement
direct ou pratiquement direct des lois de la nature. Au départ,
ce terme a une connotation péjorative et est une critique de la
pensée spencérienne.
Au sens
large, le darwinisme social inclut toute théorie qui postule une
analogie entre lois de la nature et lois de la société.
Au sens restreint, il désigne toute théorie sociale qui
s’appuie sur les points suivants :
a) les lois de la nature sont les lois de la société, car l’homme fait partie de la nature ;
b) b) les lois de la nature sont “ la survivance du plus apte ”, la lutte pour la vie, les lois de l’hérédité ;
c) Il est nécessaire pour le bien-être de l’humanité de veiller au bon fonctionnement de ces lois dans la société.
a) les lois de la nature sont les lois de la société, car l’homme fait partie de la nature ;
b) b) les lois de la nature sont “ la survivance du plus apte ”, la lutte pour la vie, les lois de l’hérédité ;
c) Il est nécessaire pour le bien-être de l’humanité de veiller au bon fonctionnement de ces lois dans la société.
On distingue classiquement deux
types de darwinisme social, qui ne sont pas exclusifs : le
darwinisme social individuel et le darwinisme social holiste. Ils se
distinguent sur le point de savoir où porte principalement la
compétition, entre qui se joue le “ struggle for
life ”. Pour les darwinistes sociaux individualistes, la
compétition est principalement entre les individus, humains ou
animaux, alors que pour les darwinistes sociaux holistes, la
compétition est avant tout entre groupes d’individus –
compétition entre espèces chez les animaux, notion
transposée à l’homme sous forme d’une compétition
entre “ races ” (avec des conceptions très variables
de ce que peut être une “ race ” humaine. Ce terme,
considéré actuellement comme sans fondement scientifique,
était alors largement employé par les scientifiques,
même si certains avaient déjà noté
dès la fin du XIXe siècle son caractère
subjectif).
Son premier et principal
théoricien est de philosophe britannique Herbert Spencer, dont
la doctrine est connue sous le nom de spencérisme. Le darwinisme
social s’inspire de la constatation de Malthus selon laquelle la
croissance d’un population est géométrique alors que la
croissance des ressources est arithmétique, d’où une
lutte pour la subsistance. La théorie spencerienne est
publiée vers 1850, soit avant l’origine des espèces.
À la publication de L’Origine
des espèces en 1859, Spencer deviendra un
darwinien farouche, voyant dans la théorie de Darwin un cas
particulier de lois générale de l’évolution. Le
darwinisme a été connu est s’est souvent répandu
par l’intermédiaire du spencérisme, l’œuvre de Spencer
étant souvent diffusée avant celle de Darwin, ce qui a
contribué à créer une certaine confusion entre
darwinisme et spencérisme.
Dans le darwinisme social
individualiste, la sélection naturelle appliquée aux
sociétés humaines fait de l’individu la cible de cette
sélection. Les lois et les mesures de protection sociale, qui
visent à améliorer le sort des plus démunis,
à atténuer les effets de la pauvreté… sont
considérées comme mauvaises car elles entravent le libre
jeu de la compétition entre individus, garant de
l’amélioration de l’espèce humaine. Le darwinisme social
préconise donc une organisation démocratique de la
société (il faut laisser aux individus la plus grande
liberté d’action possible) associée à un
laissez-faire économique (il faut laisser jouer le libre jeu de
la compétition économique, équivalent social de la
compétition pour la nourriture dans la nature) et une absence de
mesure sociale (il ne faut pas atténuer les effets de cette
sélection économique, car ce serait favoriser
“ la survie du moins apte ”).
En réalité, cette
théorie du “ laissez faire ” économique a
été développée avant Spencer, au XVIIIe
siècle, par l’économiste écossais Adam Smith.
Selon lui, l’efficacité économique maximale est obtenue
non pas par une organisation rationnelle de l’économie mais par
le simple jeu des concurrences économiques entre individus, qui
n’ont comme objectif que leur réussite propre – et non le bon
fonctionnement du système. L’efficacité du système
apparaît donc comme un « sous-produit » des
concurrences individuelles et non comme finalité d’une
organisation rationnelle. L’analogie entre lois de la nature et lois de
la société, caractéristique du darwinisme social,
permet d’utiliser la théorie de la sélection naturelle
comme justification à cette conception du laissez-faire
économique.
Cette
théorie sociale est donc une théorie sociale
individualiste, démocratique, anti-interventionniste et
opposée aux mesures sociales, trouvant sa justification dans une
loi de la nature. Elle est fondamentalement optimiste, au sens
où « si on ne fait rien, les choses se passeront
bien » : pour que la sélection naturelle,
garante du progrès de l’espèce humaine, puisse jouer, il
suffit de ne pas entraver son fonctionnement. Le darwinisme social a
été très influent en Grande-Bretagne dans la
deuxième moitié du XIXe siècle, avec une influence
déclinante à la fin du siècle, et aux Etats-Unis
jusqu’au début du XIXe.
Andrew
Carnegie, dans son essai « Wealth », considère
par exemple que « si la loi
peut sembler parfois dure pour l’individu, c’est la meilleure
pour la race, car elle assure la survivance du plus apte dans chaque
domaine. […] La loi de l’accumulation doivent rester libre. La loi de
la distribution libre. L’Individualisme doit continuer ».
Il ne s’agit
pas ici de porter un jugement moral sur les positions d’Andrew
Carnegie, qui a utilisé une partie de sa fortune à fonder
un certain nombre d’institutions philantropiques, et en particulier des
bibliothèques publiques gratuites, et qui prônait une
redistribution des richesses par les riches, mais de montrer en quoi
les références à la théorie de
l’évolution – exprimée dans les termes spencériens
de « survivance du plus apte » – sont
utilisés à l’appui d’une conception socio-politique dont
l’objet est, selon Andrew Carnegie lui-même, de résoudre
le problème « du
Riche et du Pauvre ».
Faire de la
théorie darwinienne de l’évolution par sélection
naturelle le fondement de l’organisation sociale proposée par
les darwinistes sociaux est sans justification scientifique, et Darwin
lui-même a proposé dans La
Filiation de l’homme (The
descent of man) une application de sa théorie à
l’interprétation des comportements humains opposée aux
extrapolations spencériennes. Cependant, la confusion entre
darwinisme et darwinisme social, ainsi qu’une présentation
incorrecte des idées darwiniennes, ont été dues au
fait que les présentations et les traductions de Darwin ont
été faites souvent dans un esprit spencérien (cf.
la première traduction française de L’Origine des espèces par
Clémence Boyer). L’expression “ la survivance du plus
apte ” (the survival of the fittest), souvent critiquée et
attribuée à Darwin, est une expression de Spencer – que
Darwin a repris plus tard. Au Japon, le darwinisme a été
introduit après Spencer, lui-même introduit par
l’intermédiaire d’auteurs américains. Lors de la
première traduction en japonais de L’Origine des espèces, en
1889, de nombreux ouvrages de Spencer étaient déjà
disponibles au Japon, et Darwin a été introduit à
travers une “ grille de lecture ” spencérienne,
elle-même réinterprétée et
intégrée à la culture japonaise de l’époque.
Souvent donc, derrière
le mot “ darwinisme ” se trouvait la conception
spencérienne de l’évolution et des rapports sociaux,
assez différente de celle de Darwin, et dépassant le
cadre du sujet de L’Origine des espèces, qui ne traitait pas de
l’évolution humaine ni des extrapolations possibles de la
théorie de la sélection naturelle à l’analyse des
rapports humains.
À la
différence du darwinisme social individualiste qui fait de
l’individu la cible principale de la sélection naturelle, le
darwinisme social holiste considère que l’organisme de base
cible de la sélection est la société, et que la
compétition est avant une lutte entre groupes humains, parfois
classes sociales (cf. l’analogie entre “ lutte des classes ”
et “ lutte des races ” dans Socialisme et science
positive, d’E. Ferri (1896)), le plus souvent “ races ”. Le
darwinisme social s’appuie sur l’idée de lutte entre races ou
entre espèces, et s’appuie souvent sur un essentialisme raciste
préexistant au darwinisme – mais il ne faut pas confondre
darwinisme social et théorie de l’inégalité des
races.
Il existe
diverses versions du darwinisme social holiste, qui n’est pas
d’ailleurs incompatible avec une certaine forme de darwinisme social
individualiste, le premier jouant entre les “ races ”, le
second au sein des races, la compétition interindividuelle
étant considérée comme favorable aux
“ races ”. Le darwinisme social a servi de support à
diverses théories ou comportements politiques :
théorie du progrès menant à l’atténuation
des inégalités et au développement du sentiment
national ; justification de l’expansion coloniale et de l’empire
colonial anglais (Joseph Chamberlain) ; de la lutte contre les
Indiens (Théodore Roosevelt) ; justification de la
propriété collective des moyens de production et de la
direction du progès social par quelques individus
sélectionnés (K. Pearson Darwinism, progress and eugenics,
1912) ; stricte ségrégation des “ races
inférieures… ” – alors que, toujours en s’appuyant sur
la théorie darwinienne de l’évolution, le darwinisme
social individualiste justifiait l’émergence de la
propriété individuelle comme un progrès
évolutif.
Les
différentes formes de darwinisme social ont en commun
l’idée de la vie en groupe ou “ races ” est le moteur
de l’histoire. À la différence du darwinisme social
individualiste, il est est hanté par l’idée –
préexistante au darwinisme social – de la décadence des
“ races ”. Selon cette conception, les lois de la nature ne
peuvent plus s’exercer dans les sociétés modernes, et il
est donc nécessaire de mettre en place des mesures de
sélection artificielle, idée qui a donné naissance
à l’eugénisme.
Eugénisme
L’eugénisme pré-galtonien
Le mot
“ eugénisme ” a été créé
par un cousin de Charles Darwin, Francis Galton (1822–1911), et a
été exposé en tant que théorie dans son
ouvrage sur le « caractère héréditaire
du génie » en 1869. Toutefois, l’idée et les
pratiques que l’on peut qualifier d’eugénistes sont très
largement antérieures à F. Galton. Il s’agit de pratiques
courantes dans un grand nombre de sociétés, associant le
contrôle de la procréation et l’élimination des
indésirables, souvent associées à un mythe de la
dégénérescence. On trouve en particulier dans
Platon et Aristote la justification d’un eugénisme
institutionnel.
L’avènement de la religion chrétienne verra un
arrêt des pratiques eugéniques institutionnelles, dont la
théorisation réapparaîtra à la Renaissance
chez certains utopistes. On trouve par exemple l’exposé de
quelques pratiques eugénistes dans les ouvrages de Thomas More (Utopia) et de Tomaso Campanella (La Cité du soleil). Dans La Cité du soleil, par
exemple, il existe « un
magistrat spécialement préposé à la
génération, et qui est un très habile
médecin » qui décide des unions
matrimoniales : « Les
femmes grandes et belles ne sont unies qu’à des hommes grands et
bien constitués ; les femmes qui ont de l’embonpoint ne
sont unis qu’à des hommes secs, et celles qui n’en ont pas sont
réservés à des hommes gras, pour que les divers
tempéraments se fondent et qu’ils produisent une race bien
constituée ».
En France,
au cours du XIXe siècle, apparaîtra une eugénisme
médical pré-galtonien, se limitant à des
recommandations pratiques de restrictions matrimoniales, de
dépistage des maladies vénériennes,
associées à des recommandations d’hygiène et
d’éducation (puériculture, terme inventé par
le médecin français Caron en 1865). Toutefois, c’est
Francis Galton qui inventa le mot eugénisme et théorisa
cette notion en tendant de lui donner une assise scientifique.
L’eugénisme de Francis Galton
La
définition de l’eugénisme donné par Francis Galton
est la suivante : “ science de l’amélioration de la
race, qui ne se borne nullement aux questions d’unions judicieuses,
mais qui, particulièrement dans le cas de l’homme, s’occupe de
toutes les influences susceptibles de donner aux races les mieux
douées un plus grand nombre de chances de prévaloir sur
les races les moins bonnes ”.
Francis Galton s’appuie sur la théorie de l’évolution par
sélection naturelle de Darwin, et sur des études sur la
« transmission héréditaire du
génie ». Il adopte dans un premier temps la
théorie de la pangénèse de Darwin, pour la
rejeter. Il traduit les conflits sociaux en terme biologiques,
expliquant les inégalités sociales par des
inégalités biologiques, et les classes sociales sont
presque assimilées à des « races »
différentes. Francis Galton définit une
“ élite sociale ” – juges, ingénieurs,
scientifiques… – qu’il assimile à une
« élite biologique », et
préconise une amélioration délibérée
de la « race humaine » par des mesures favorisant
la reproduction de « l’élite biologique »
menacée par la « prolifération des
pauvres ».
Les préconisations eugénistes
L’eugénisme
développé en Grande-Bretagne par Francis Galton et des
biométriciens, en particulier K. Pearson, se répand assez
rapidement en Europe et en Amérique du Nord, et des
sociétés d’eugénisme regroupant des scientifiques
sont créées dans plusieurs pays. Un certain nombre
d’ouvrages sont publiés et des mesures
préconisées. Cependant, des mesures eugénistes ne
seront pas prises par tous les pays où elles ont
été préconisées. La Grande-Bretagne, par
exemple, alors qu’elle a vu naître l’eugénisme, n’a pas
pris de mesures eugénistes. Des sociétés
d’eugénisme sont apparues à la fin du XIXe siècle
ou au début du XXe dans de nombreux pays d’Amérique du
Nord et en Europe, organisées en une fédération
internationale. Les mesures préconisées sont
classiquement classées en « eugénisme
positif », mesures d’encouragement spécifique
à la procréation des individus
« eugéniquement supérieurs », et en
« eugénisme négatif », mesures
visant à diminuer ou supprimer la procréation des
individus considérés comme
« eugéniquement inférieurs », de
degrés divers allant de la recommandation de la
non-procréation à l’élimination physique.
En mettant l’accent sur le caractère héréditaire
des caractéristiques des individus et sur
l’hérédité comme cible privilégiée
des mesures à prendre, les préconisations
eugénistes sont parfois entrées en contradiction avec les
préconisations hygiénistes, qui faisaient du milieu la
cible privilégiées des mesures à prendre.
Grande-Bretagne
Sous
l’influence de Francis Galton, une chaire d’eugénisme est
créée à l’université. La principale
préoccupation en Grande-Bretagne est la création d’un
prolétariat urbain important suite à la révolution
industrielle et à la dépopulation des campagnes. Certains
y voient une menace pour la civilisation : “ le déclin
des civilisations est dû à la prolifération
désordonnée des classes populaires ”. Pour K.
Pearson, une stricte ségrégation des “ races
inférieures ” est également nécessaire :
“ L’homme blanc doit complètement expulser la race
inférieure ”. La reproduction des déficients mentaux
est également considérée comme une menace pour la
“ race ”, et des mesures d’internement des déficients
mentaux à but de ségrégation sexuelle sont
préconisées. Des mesures eugénistes seront
défendues par un certain nombre de statisticiens et
biométriciens : Pearson, Fisher…
Etats-UnisAux
Etats-Unis, les eugénistes se préoccupent des
conséquences de l’immigration. Des tests sont effectués
pour essayer de démontrer l’insuffisance mentale des
émigrés originaires d’Europe du Sud de l’Est. Le
président des Etats-Unis C. Coolidge déclare : ""Les lois biologiques montrent que les
Nordiques se détériorent lorsqu’ils se mélangent
à d’autres races." La justification des mesures de
restriction à l’immigration est « la nécessité de garder le
sang pur de l’Amérique ».
Outre les mesures de restriction à l’immigration, les
préconisations concernent l’interdiction du mariage ou des
relations sexuelles aux personnes jugées eugéniquement
inaptes, l’internement des anormaux et/ou leur stérilisation,
voire l’euthanasie de certains nouveau-nés handicapés.
Un certain nombre de ces mesures
eugénistes, soit au niveau des états, soit au niveau
fédéral, concernent la restriction à l’immigration
(Restriction Immigration Act, 1924), les restrictions à la
procréation, l’internement et la stérilisation
d’individus “ dysgéniques ”.
France
En France,
des mesures eugénistes ont également été
préconisées. On trouve en particulier des écrits
de Charles Richet (La
Sélection humaine, 1912) et d’Alexis Carrel (L’Homme, cet inconnu, 1935), tous
deux prix Nobel de Médecine.
Les conceptions d’Alexis Carrel défendues dans L’Homme, cet inconnu montre les caractéristiques principales du darwinisme social holiste : constatation de l’absence de sélection naturelle dans la civilisation actuelle, obsession de la dégénérescence de la “ race ” et de la civilisation liées à la faible natalité des classes “ supérieures ”, la prolifération des “ races inférieures ”, la multiplication des attardés mentaux, l’idée que les classes sociales reflètent – et doivent refléter – avant tout les inégalités biologiques :
“ Dans les nations les plus civilisées, la reproduction diminue et donne des individus inférieurs. ”
“ Des mutations se produisent chez l’homme comme chez les animaux. On rencontre, même chez les prolétaires, des sujets capables d’un haut développement. Mais ce phénomène est peu fréquent. En effet, la répartition de la population d’un pays en différentes classes n’est pas l’effet du hasard, ni de conventions sociales. Elle a une base biologique profonde. ”
Les préconisations d’Alexis Carrel sont la constitution d’un
“ Conseil des Sages ” représentant l’élite
intellectuelle auquel les autorités politiques doivent se
référer, constitution d’une “ élite
biologique héréditaire ” dont on facilitera la
reproduction par des mesures incitatives (fiscales par exemple) et la
mise en place d’un “ eugénisme volontaire ” pour
inciter les individus inférieurs à ne pas se reproduire,
élimination des criminels et éventuellement de certains
fous par gazage :
Les conceptions d’Alexis Carrel défendues dans L’Homme, cet inconnu montre les caractéristiques principales du darwinisme social holiste : constatation de l’absence de sélection naturelle dans la civilisation actuelle, obsession de la dégénérescence de la “ race ” et de la civilisation liées à la faible natalité des classes “ supérieures ”, la prolifération des “ races inférieures ”, la multiplication des attardés mentaux, l’idée que les classes sociales reflètent – et doivent refléter – avant tout les inégalités biologiques :
“ Nous savons que la sélection
naturelle n’a pas joué son rôle depuis longtemps. Que
beaucoup d’individus inférieurs ont été
conservés grâce aux efforts de l’hygiène et de la
médecine. Que leur multiplication a été nuisible
à la race. ”
“ Un effort naïf est fait par les
nations civilisées pour la conservation d’être inutiles et
nuisibles ”.
“ La
vie moderne nous a apporté […] l’extinction des meilleurs
éléments de la races […]. La France se dépeuple
déjà. L’Angleterre et la Scandinavie se
dépeupleront bientôt. Aux États-Unis, le tiers
supérieur de la population se reproduit beaucoup plus rapidement
que le tiers inférieur […]. Au contraire, les races africaines
et asiatiques, telles que les Arabes, les Indous, les Russes,
s’accroissent avec une grande rapidité. ”
“ Dans les nations les plus civilisées, la reproduction diminue et donne des individus inférieurs. ”
“ Des mutations se produisent chez l’homme comme chez les animaux. On rencontre, même chez les prolétaires, des sujets capables d’un haut développement. Mais ce phénomène est peu fréquent. En effet, la répartition de la population d’un pays en différentes classes n’est pas l’effet du hasard, ni de conventions sociales. Elle a une base biologique profonde. ”
“ Il
y a besoin d’une institution capable de diriger de façon
ininterrompue les recherches d’où dépend l’avenir de
notre civilisation. […] Les chefs démocratiques, aussi bien que
les dictateurs, pourraient puiser à cette source de
vérité scientifique les informations dont ils ont besoin
pour développer une civilisation réellement
humaine. ”
“ Pour la perpétuation de l’élite, l’eugénisme est indispensable. Il est évident qu’une race doit reproduire ses meilleurs éléments ”.
“ L’établissement par l’eugénisme d’une aristocratie biologique héréditaire serait une étape importante vers la solution des grands problèmes de l’heure présente ”.
“ Pour la perpétuation de l’élite, l’eugénisme est indispensable. Il est évident qu’une race doit reproduire ses meilleurs éléments ”.
“ L’établissement par l’eugénisme d’une aristocratie biologique héréditaire serait une étape importante vers la solution des grands problèmes de l’heure présente ”.
“ Le conditionnement des criminels
les moins dangereux par le fouet, ou quelques autre moyen plus
scientifique, suivi d’un court séjour à l’hôpital,
suffirait probablement à assurer l’ordre. Quant aux autres […],
un établissement euthanasique, pourvu de gaz appropriés,
permettrait d’en disposer de façon humaine et économique.
Le même traitement ne serait-il pas applicable aux fous qui ont
commis des actes criminels ? ”.
Les constatations de Charles
Richet ne sont pas très différentes :
“ Il est prouvé, par tout un
ensemble de preuves inattaquables, que la race jaune, et surtout la
noire, sont absolument inférieures à la race blanche. […]
Il faut, très amicalement, très sympathiquement, les
tenir à distance ”.
“ Laissons la sélection naturelle, et ayons le courage de faire une sélection sociale, plus rapide, plus efficace que la sélection naturelle. De même que l’homme a pu perfectionner des espèces animales, de même il pourra, s’il veut s’en donner la peine, perfectionner sa propre espèce. […] Lorsqu’il s’agira de la race jaune, et, à plus forte raison, de la race noire, pour conserver, et surtout pour augmenter notre puissance mentale, il faudra pratiquer non plus la sélection individuelle, comme avec nos frères les Blancs, mais la sélection spécifique, en écartant résolument tout mélange avec les races inférieures. […] Après l’élimination des races inférieures, le premier pas dans la sélection, c’est l’élimination des anormaux. […] La sélection ne sera efficace que si elle est sévère, et la sévérité, c’est l’élimination des mauvais. Or les mauvais ne vont pas disparaître de leur plein gré. Il faudra donc une autorité pour les éliminer de la société humaine. ”
“ Un moyen de les [les anormaux] éliminer, que notre veulerie et notre philanthropie larmoyante nous empêche d’adopter, serait de les stériliser ”.
Allemagne“ Laissons la sélection naturelle, et ayons le courage de faire une sélection sociale, plus rapide, plus efficace que la sélection naturelle. De même que l’homme a pu perfectionner des espèces animales, de même il pourra, s’il veut s’en donner la peine, perfectionner sa propre espèce. […] Lorsqu’il s’agira de la race jaune, et, à plus forte raison, de la race noire, pour conserver, et surtout pour augmenter notre puissance mentale, il faudra pratiquer non plus la sélection individuelle, comme avec nos frères les Blancs, mais la sélection spécifique, en écartant résolument tout mélange avec les races inférieures. […] Après l’élimination des races inférieures, le premier pas dans la sélection, c’est l’élimination des anormaux. […] La sélection ne sera efficace que si elle est sévère, et la sévérité, c’est l’élimination des mauvais. Or les mauvais ne vont pas disparaître de leur plein gré. Il faudra donc une autorité pour les éliminer de la société humaine. ”
“ Un moyen de les [les anormaux] éliminer, que notre veulerie et notre philanthropie larmoyante nous empêche d’adopter, serait de les stériliser ”.
Une
société d’eugénisme est créé en
1913. En 1927 est créé l’institut Kaiser Wilhem
d’anthropologie, de génétique humaine et
d’eugénisme. Des recommandations sont faites, sous l’influence
des mesures prises aux Etats-Unis, par exemple en faveur de la
stérilisation des arriérés, mentaux, des sourds,
muets et des enfants “ incapables d’apprendre ”. Le concept
de vie négative, l’idée du droit à la mort des
incurables et de l’élimination des faibles avaient
été développés à la fin du XIXe
siècle (Alfred Jost, Alfred Ploetz), avaient contribué
à relativiser la valeur accordée à la vie humaine.
Ces recommandations eugénistes sont antérieures à
l’avènement du nazisme. Des savants juifs participent au projet
eugéniste. Le parti communiste et une partie des socialistes se
déclarent favorables à la stérilisation des
anormaux.
Les mesures eugénistes
Un certain
nombre de pays, mais pas tous ceux où les recommandations
eugénistes ont été faites, ont pris dans la
première moitié du vingtième siècle des
mesures eugénistes. Elles ont concerné :
- les mesures touchant à la reproduction :
o mesures concernant le mariage ou les relations sexuelles
o mesures concernant la stérilisation des anormaux
o mesures sus les avortements eugénistes
- restriction de l’immigration ;
- internement des anormaux ;
- euthanasie des anormaux.
- les mesures touchant à la reproduction :
o mesures concernant le mariage ou les relations sexuelles
o mesures concernant la stérilisation des anormaux
o mesures sus les avortements eugénistes
- restriction de l’immigration ;
- internement des anormaux ;
- euthanasie des anormaux.
Les pays
ayant mis en place des mesures eugénistes sont essentiellement
des pays d’Amérique du Nord (USA, Canada), et d’Europe du Nord,
à l’exception de la Grande-Bretagne. Nous présenterons,
sans prétention à l’exhaustivité, les principales
mesures eugénistes prises dans les principaux pays
concernés.
Etats-Unis
Restriction à l’immigration
Au
début du XXe siècle, certains eugénistes
américains se sont préoccupés des performances
intellectuels des immigrants. Les tests de mesure du coefficient
intellectuel, mis au point par le français Alfred Binet, ont
été modifiés et utilisés pour essayer de
démontrer l’insuffisance mentale des immigrés d’Europe du
Sud et de l’Est. Les pressions des eugénistes ont abouti en 1924
à des mesures de restriction de l’immigration en fonction de
l’origine géographique des immigrants (Restriction Immigration
Act, 1924).
Mesures touchant à la procréation
Les
premières mesures ont été prises en 1906 par
certains états américains. Les premières lois
interdisaient le mariage ou les relations sexuelles dans un certain
nombre de cas : maladies transmissibles, ivrognerie
invétérée, personnes “ eugéniquement
inaptes ” si la femme a moins de 45 ans. Des mesures
similaires furent prises dans d’autres états, associées
à des mesures de stérilisation (cf. infra), voire des
mesures d’euthanasie des nouveau-nés handicapés (mais ces
dernières mesures furent invalidées par la cour
suprême).
Les mesures de stérilisation obligatoires ont été prises dans des cas de maladies mentales, d’arriération mentale, de criminalité. Les stérilisations ont été validée au niveau fédéral par la cour suprême des Etats-Unis (Affaire Buck contre Bell, 1927). Entre 1907 et 1949, 50193 stérilisations (surtout par castration) ont été réalisées (20.000 hommes et 30.000 femmes).
Les mesures de stérilisation obligatoires ont été prises dans des cas de maladies mentales, d’arriération mentale, de criminalité. Les stérilisations ont été validée au niveau fédéral par la cour suprême des Etats-Unis (Affaire Buck contre Bell, 1927). Entre 1907 et 1949, 50193 stérilisations (surtout par castration) ont été réalisées (20.000 hommes et 30.000 femmes).
Allemagne
Des
recommandations d’eugénisme positif et négatif ont
été faites dès les années 1910. Dans les
années 20, les malades des hôpitaux psychiatriques ne
recevaient pas de soins. Dans certains établissements (ex :
asile de Herborn), l’euthanasie par dénutrition et maladie
était effective. Les premières mesures légales ont
été prises par les nazis en 1933. Sur la base de cette
législation, la stérilisation des handicapés
mentaux a concerné un grand nombre de personnes. Les estimations
faites varient dans une fourchette assez large, mais on estime, par
exemple, le nombre des castrations effectuées entre 1934 et 1936
entre 200.000 et 250.000 personnes, la mortalité due aux
interventions chirurgicales étant estimée à
plusieurs milliers.
Ces stérilisations se sont poursuivies jusqu’en 1939. Le 1er septembre 1939, une lettre d’Adolf Hitler décrète l’élimination physique des malades mentaux. Des formulaires et des procédures de déclarations ont été mises en place. Les handicapés mentaux ainsi identifiés étaient dirigés vers un centre d’observation, puis vers un centre d’élimination. La mise à mort s’est effectuée d’abord par injection (morphine-scopolamine), puis par gazage (monoxyde d’azote, gaz d’échappement, zylkon B). Les corps étaient ensuite incinérés, les cendres retournées aux familles avec un certificat de décès et une lettre de condoléances. 70.000 à 75.000 handicapés ont été victimes de cette politique d’élimination entre 1939 et 1941. Face aux protestations, ces mesures furent officiellement supprimées le 24 août 1941. Toutefois, l’élimination des handicapés mentaux internés a continué par la faim, les infections naturelles… La politique d’extermination mise en place par les nazis s’est portée sur les Juifs et les Tziganes. Le 31 juillet 1941, Göring charge Heydrich d’obtenir une “ solution totale ” à la “ question juive ”. Le 20 janvier 1942, à la conférence de Wansee, les responsables nazis adoptent définitivement la décision d’exterminer systématiquement les Juifs et les Tziganes. Les équipes qui travaillaient à l’euthanasie des malades mentaux sont utilisées pour l’élimination des Juifs et les Tziganes. Cinq à six millions de Juifs et 40.000 à 50.000 Tziganes sont morts victimes de la politique d’extermination raciale des nazis.
Autres pays concernés
par des mesures de stérilisations eugéniquesCes stérilisations se sont poursuivies jusqu’en 1939. Le 1er septembre 1939, une lettre d’Adolf Hitler décrète l’élimination physique des malades mentaux. Des formulaires et des procédures de déclarations ont été mises en place. Les handicapés mentaux ainsi identifiés étaient dirigés vers un centre d’observation, puis vers un centre d’élimination. La mise à mort s’est effectuée d’abord par injection (morphine-scopolamine), puis par gazage (monoxyde d’azote, gaz d’échappement, zylkon B). Les corps étaient ensuite incinérés, les cendres retournées aux familles avec un certificat de décès et une lettre de condoléances. 70.000 à 75.000 handicapés ont été victimes de cette politique d’élimination entre 1939 et 1941. Face aux protestations, ces mesures furent officiellement supprimées le 24 août 1941. Toutefois, l’élimination des handicapés mentaux internés a continué par la faim, les infections naturelles… La politique d’extermination mise en place par les nazis s’est portée sur les Juifs et les Tziganes. Le 31 juillet 1941, Göring charge Heydrich d’obtenir une “ solution totale ” à la “ question juive ”. Le 20 janvier 1942, à la conférence de Wansee, les responsables nazis adoptent définitivement la décision d’exterminer systématiquement les Juifs et les Tziganes. Les équipes qui travaillaient à l’euthanasie des malades mentaux sont utilisées pour l’élimination des Juifs et les Tziganes. Cinq à six millions de Juifs et 40.000 à 50.000 Tziganes sont morts victimes de la politique d’extermination raciale des nazis.
Outre
l’Allemagne et les Etats-Unis, les pays où furent prises des
mesures de stérilisations eugéniques sont : Canada,
Suisse, Estonie, pays scandinaves, Japon.
L’eugénisme post-nazi
La fin de la
seconde guerre mondiale et la prise de conscience des atrocités
nazies a entraîné un déclin de l’eugénisme.
L’avènement de la biologie moléculaire et une autre
approche de la génétique, de l’anthropologie… a aussi
contribué à invalider les bases scientifiques sur
lesquelles les préconisations eugénistes s’appuyaient.
Toutefois, toutes les mesures législatives mises en place avant
la seconde guerre mondiale n’ont pas été abolies à
la fin de la guerre. Les dernières mesures législatives
sur la stérilisation des handicapés mentaux, par exemple,
n’ont été supprimées qu’au début des
années 70.
D’autre part, des mesures eugénistes, essentiellement d’eugénisme positif, ont été proposées après la 2e guerre mondiale, comme les préconisations faites par Muller aux Etats-Unis de collection de sperme des “ grands hommes ” pour insémination artificielle. Des législations à justifications eugénistes concernant la procréation ont été prises à Singapour et en Chine. Au Pérou, une campagne de stérilisation effectuée à partir du début des années 90 a été accusée d’être à visée eugéniste, les stérilisations portant principalement sur les populations pauvres et d’origine indienne. En juillet 2002, une sous-commission du parlement péruvien a recommandé l’inculpation de l’ancien président Alberto Fujimori – en fuite au Japon en raison d’un scandale financier – et de plusieurs anciens ministres pour génocide. Selon la commission, 314 000 femmes et 24650 hommes ont été stérilisés. Selon l’accusation, un certain nombre de ces stérilisations auraient été forcées, avec l’instauration de quotas dans les régions pauvres du pays.
D’autre part, des mesures eugénistes, essentiellement d’eugénisme positif, ont été proposées après la 2e guerre mondiale, comme les préconisations faites par Muller aux Etats-Unis de collection de sperme des “ grands hommes ” pour insémination artificielle. Des législations à justifications eugénistes concernant la procréation ont été prises à Singapour et en Chine. Au Pérou, une campagne de stérilisation effectuée à partir du début des années 90 a été accusée d’être à visée eugéniste, les stérilisations portant principalement sur les populations pauvres et d’origine indienne. En juillet 2002, une sous-commission du parlement péruvien a recommandé l’inculpation de l’ancien président Alberto Fujimori – en fuite au Japon en raison d’un scandale financier – et de plusieurs anciens ministres pour génocide. Selon la commission, 314 000 femmes et 24650 hommes ont été stérilisés. Selon l’accusation, un certain nombre de ces stérilisations auraient été forcées, avec l’instauration de quotas dans les régions pauvres du pays.
conclusion
Depuis la fin de
la Seconde guerre mondiale et la découverte de
la politique d’extermination menée par l’Allemagne nazie, le mot
eugénisme a pris une connotation péjorative. Il ne faut
cependant pas oublier qu’avant 1945 l’eugénisme était
considéré comme une pratique scientifique et
progressiste. L’extrapolation de la théorie de
l’évolution à ce qu’on a appelé dès la fin
du XIXe siècle le darwinisme social, soit individualiste, soit
holiste, a été suivie voire initiée par de
nombreux scientifiques et a influencé des mouvements ou des
parties de tous bords politiques. Il convient donc de se garder de
simplifications abusives et d’anachronismes d’analyse. En ce qui
concerne des questions de bioéthique qui peuvent se poser
aujourd’hui compte tenu de l’évolution des méthodes
diagnostiques et pratiques biomédicales, il convient aussi de se
méfier d’analyses superficielles qui se contentent d’attacher un
mot à une pratique pour la légitimer ou la condamner.
Catherine Bachelard-Jobard. L’Eugénisme, la science et le droit. PUF, Paris, 2001. (BU)
Stephen J. Gould. La Malmesure de l’Homme, Ramsay, Paris, 1983.
Daniel J. Kevles. Au nom de l’eugénisme. PUF, Paris, 1996. (BU)
Patrick Tort et al. Dictionnaire du darwinisme et de l’évolution. PUF, Paris, 1996. (BU)
Andrew Carnegie. Wealth. North American Review.CCCXCI. Juin, 1889.
Alexis Carrel. L’Homme, cet inconnu. Plon, Paris, 1935, réédition 1956.
Charles Darwin. The Origin of species (texte de la 1re édition). PenguinBooks, London, 1985.